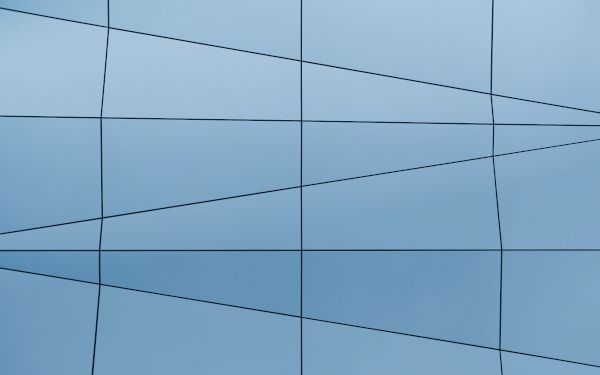- Revue
- Type du support : Revue
Appel à publications
La recherche qualitative est apparue au début du XXe siècle pour répondre aux limites des études statistiques, jugées insensibles aux réalités multiples et singulières des acteur·trices de terrain; les premiers travaux en anthropologie et en sociologie ont pavé la voie, en jetant les bases d’une façon de faire la recherche au plus près des terrains d’enquête et ayant des visées distinctes des recherches quantitatives qui dominaient alors (Morrissette et Demazière, 2019). Dans ce contexte, les idées ont foisonné et de nombreuses innovations ont été proposées pour investir les terrains d’enquête et en tirer des analyses crédibles, innovations devenues aujourd’hui des traditions de recherche qualitative (par exemple, l’ethnométhodologie, la théorie ancrée, etc.). Au cours de ces dernières décennies, la revue Recherches qualitatives a participé de façon incrémentale aux débats de la communauté scientifique francophone et à la diffusion de réflexions méthodologiques, contribuant ainsi au développement de ce champ et à sa vitalité.

- Type du support : Revue
Appel à publications
Ce projet de numéro s’inscrit dans la continuité du numéro 59, paru également dansla revue Tréma en 2023, et qui était consacré à l’innovation en lecture et en écriture (coordonné par Dufays et Brunel). L’objet du présent projet consiste à mettre enrelation deux ensembles de questionnements à priori disjoints et relativement peuexplorés encore par le champ de la didactique de la littérature : celui qui concerne lesdifficultés de lecture et celui qui étudie les « innovations » pédagogiques.
Dans cetteorientation, nous visons à soutenir le travail des enseignants et à apporter des appuis àleur propre réflexion, souvent particulièrement orientée vers leurs élèves les plusfragiles, en nous écartant d’un discours promouvant l’innovation de manière absolue oudescendante. C’est bien dans l’accompagnement du processus de transformation del’activité professionnelle, et en portant attention à la réalité du travail de l’élève face auxdifficultés d’apprentissage, que nous nous situons. Notons d’emblée que, bien que secumulent souvent les difficultés, il ne sera pas question à priori dans ce numérod’examiner spécifiquement les problèmes posés par le travail avec les élèves nonfrancophones ou handicapés.
Ainsi, il s’agit d’ouvrir des pistes de réflexion à partir de laquestion suivante : dans quelle mesure les recherches en didactique de la littératurepeuvent-elles soutenir des innovations favorisant la prise en compte de la difficulté ausein des contextes scolaires ? Dans quelle mesure ces recherches reconsidèrent-elles lanotion de difficulté et prennent-elles en compte de nouveaux enjeux, plus inclusifs, del’école du XXIe siècle ?

- Type du support : Revue
Appel à publications
« Des traces écrites des apprenants et ce que l’on en fait » (Titre provisoire)
Coordination : Aurore Promonet, Kathy Similowski & Jacques David
15 mars 2025 : réception des propositions d’article
L’expression trace écrite est ordinairement employée dans le monde scolaire. Elle ne suscite guère de controverses ni même de demandes d’explicitation. La trace écrite scolaire apparait comme un allant de soi ; elle relève d’un jargon professionnel. Elle désigne ce que les enseignants et enseignantes décident de faire noter à leurs élèves dans les cahiers carnets, classeurs.
Dans un dossier dédié aux usages de l’écrit en histoire et géographie dans l’enseignement primaire et secondaire français, et à partir de l’observation d’une quinzaine de cours en collège, dans le cadre d’une recherche INRP, François Audigier déclare : "Dans une forme d'enseignement où domine le cours dialogué, [...] l'écrit est une concrétisation de la phase orale, [...] ; il sert essentiellement à institutionnaliser le savoir ; rarement produit de l'élève, on ne rencontre guère le brouillon ; la trace écrite par les élèves est le plus souvent une copie de ce que l'enseignant écrit au tableau, textes ou phrases rassemblant les contenus jugés importants, les définitions, le vocabulaire spécifique, les dates. (2000 : 8)". En historienne de l’éducation, Anne-Marie Chartier définit l’écriture du quotidien scolaire, en particulier à l’école primaire, à travers le prisme de la notion de trace : « Pour connaitre l’histoire de l’écriture scolaire, il faut étudier ses traces » (2022 : 15). Elle désigne « les cahiers, les leçons manuscrites, les notes de cours, les brouillons, les copies d’examen » comme un ensemble d’archives qui documentent le réel de la classe en complément des règlements et discours institutionnels